Femmes et littérature : une question politique (1)
Le débat sur la place des femmes dans les programmes scolaires s’est longtemps cantonné aux programmes d’histoire. Depuis quelques années, il touche aussi l’enseignement de la littérature. Ce débat soulève des questions à la fois scientifiques (touchant à la connaissance que nous avons du passé) et politiques : comment l’enseignement peut-il articuler la transmission des connaissances produites par la recherche, la transmission d’un patrimoine qui valorise ces connaissances de manière différenciée, les hiérarchise (le canon littéraire), et la transmission des moyens de produire soi-même des connaissances et des valeurs nouvelles ? La question de l’égalité (entre femmes et hommes, mais le même raisonnement pourrait s’appliquer aux inégalités sociales) rencontre ici celle de l’émancipation.
Voir aussi : Ce que les femmes font à l’idée de littérature. L’écriture féminine et la Révolution.
Ce que les femmes font aux programmes scolaires
Madame de La Fayette au baccalauréat
L’année dernière, une enseignante de français, Françoise Cahen, a constaté qu’aucune femme de lettres n’avait jamais figuré au programme de littérature du baccalauréat[1]Il ne s’agit pas de l’épreuve de français que tous les bacheliers passent à la fin de l’année de 1ère, et dont le programme prescrit des genres et des mouvements littéraires mais laisse le choix des auteurs étudiés aux enseignants. L’épreuve de littérature est réservée aux bacheliers de la série littéraire, qui la passent en fin de Terminale.. Elle a lancé une pétition[2]https://www.change.org/p/najatvb-donnez-leur-place-aux-femmes-dans-les-programmes-de-littérature-au-bac-l qui a rencontré un succès rapide, a été relayée par les médias… et voilà : cette année, Madame de La Fayette est au programme du Bac, avec La Princesse de Montpensier, sa première nouvelle. L’événement n’est pas isolé. Depuis juin 2017, la plateforme « George : le deuxième texte »[3]http://george2etexte.free.fr met des textes écrits par des femmes à disposition des enseignants. L’absence de femmes au programme de l’agrégation de lettres pour 2018 a suscité l’indignation, et une nouvelle pétition[4]https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-pas-d-agrégation-de-lettres-sans-autrice.
Ces mobilisations s’inscrivent dans la continuité d’une réflexion déjà ancienne sur les stéréotypes sexistes et leur transmission dans l’éducation. En 2012, un rapport du centre Hubertine-Auclert[5]Centre Hubertine Auclert. Sexes et manuels : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/sexes-manuels relevait que 95% des textes littéraires et théoriques figurant dans les manuels de seconde avaient des auteurs masculins. L’absence de femmes dans l’enseignement de la littérature contribue à transmettre l’idée que seuls les hommes peuvent écrire, inventer, créer. Les femmes, qui représentent la majorité des enseignants de français et des élèves de la filière littéraire, sont là pour admirer. Récemment, un inspecteur général écrivait ainsi que l’explication de texte implique « une certaine féminité de la posture » : « se disposer à recevoir la grâce d’un don »[6]Patrick Laudet, « Explication de texte littéraire, un exercice à revivifier », juin 2011. Ce texte est mis à disposition des enseignants sur le site Eduscol : http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf. Le même Patrick Laudet a été mis en cause en 2016 pour le sexisme du rapport de jury du CAPES de Lettres.. Hommes créateurs, femmes passives : l’enseignement de la littérature contribue à naturaliser la domination masculine.
Paradoxalement, ce sont pourtant les filles qui réussissent le mieux en français au collège et au lycée. Les attendus de la discipline – savoir exprimer ses émotions, à l’oral et à l’écrit, adopter une posture d’écoute… – sont en effet proches de comportements socialement construits comme féminins, et que les filles apprennent dans leur famille plus que les garçons. Les contenus sexistes de l’enseignement n’empêchent pas les filles de réussir. Les pratiques pédagogiques et les pré-requis sur lesquels elles reposent, par contre, créent des inégalités de réussite au détriment des garçons. Cela signifie-t-il qu’il ne sert à rien de faire entrer des femmes dans les programmes de français ?
L’idée que je voudrais défendre ici est que la mise au programme d’écrivaines peut modifier en profondeur la manière de concevoir et de pratiquer l’enseignement du français, et permettre l’émergence d’un enseignement à la fois plus égalitaire (du point de vue du genre et du point de vue social) et plus émancipateur.
S’il est nécessaire de faire plus de place aux femmes de lettres, c’est d’abord pour des raisons scientifiques. En effet, les femmes écrivent, et depuis longtemps. Au 17e siècle, presque tous les contes de fées sont écrits par des femmes : pourquoi étudier ceux de Charles Perrault, quasiment le seul homme à avoir pratiqué ce genre ? Au 18e siècle, les romancières représentent 10% des publications, et 20% au 19e siècle. On est loin des 5% des manuels ! Pourquoi ces ouvrages ont-ils disparu de l’histoire littéraire ? Parce qu’ils étaient moins bons ?
Dans une société structurée par la domination masculine, l’écriture féminine a souvent dû se cantonner à des « petits genres » comme le conte, la nouvelle ou le roman sentimental. D’un autre côté, les genres féminins ont rapidement été perçus comme illégitimes. Le cas du conte de fées est révélateur : genre politique et polémique sous la plume de Charles Perrault, il est désigné au cours du 18e siècle et à mesure que de nombreuses femmes s’y essaient comme un genre destiné aux enfants. Les genres et les publics de l’écriture féminine sont peu légitimes. Pour écrire des romans réalistes, George Sand a pris un pseudonyme masculin.
“ Le canon littéraire est
l’équivalent du roman national : un mythe construit à partir du 19e siècle dans une perspective de glorification de la culture française. ”
À ces contraintes qui façonnent l’écriture s’ajoute la sélection opérée par l’histoire littéraire, qui repose elle aussi sur des valeurs sexistes. Conservons l’exemple de George Sand : ses romans les plus engagés comme ses romans historiques ne sont plus enseignés. Les manuels ne retiennent d’elle que ce qui correspond à l’idée qu’on se fait d’une écriture féminine : les romans pastoraux, où l’on célèbre la nature et dont les héros sont des enfants, La Petite Fadette et François le Champi. L’histoire littéraire s’est construite en valorisant les « grands auteurs », comme l’histoire nationale a valorisé les grands hommes. Le canon littéraire est l’équivalent du roman national : un mythe construit à partir du 19e siècle dans une perspective de glorification de la culture française.
“ L’enseignement de la littérature n’a pas seulement pour visée la transmission d’un patrimoine, mais aussi la compréhension des pratiques culturelles. ”
Faire entrer les femmes dans les programmes scolaires, c’est faire évoluer ce canon pour le rapprocher de la réalité historique – ou du moins de ce que nous en connaissons. C’est donc aussi accepter que l’enseignement de la littérature n’a pas seulement pour visée la transmission d’un patrimoine, mais aussi la compréhension des pratiques culturelles. C’est une réorientation radicale de l’enseignement des lettres, qui a été tentée à plusieurs reprises et qui a toujours suscité la polémique[7]Ce fut le cas notamment avec les programmes de français de 2001, élaborés par un groupe d’experts présidé par Alain Viala, qui suscitèrent une très violente polémique. Voir notamment : A. Viala, « Querelles et légitimations », Carnets [En ligne], 9, 2017 : http://carnets.revues.org/1995.
Poser la question de la place des femmes écrivains dans l’enseignement de la littérature pourrait avoir trois conséquences majeures.
D’abord, faire une plus grande place aux femmes devrait faire évoluer l’enseignement de la littérature d’un modèle fondé sur la célébration des grands hommes, du génie créateur d’individus désignés comme hors du commun, à un modèle insistant sur la dimension sociale, collective de la pratique littéraire. Prenons à nouveau l’exemple des contes de fées. Enseigner les contes de Mme d’Aulnoy, de Marie-Jeanne L’Héritier ou de Mme de Murat à côté de ceux de Perrault mettrait en valeur la dimension sociale de l’écriture des contes : leur inscription dans une sociabilité mondaine, leur rôle dans la promotion d’un groupe de femmes et d’hommes de lettres (les « galants »), leur fonction polémique à un moment où ce groupe et l’esthétique qu’il défend sont attaqués… Au lieu de prétende extraire la littérature du monde social, en affirmant son universalité (on étudie des « classiques » capables de traverser le temps), un tel enseignement permettrait de comprendre la pratique littéraire comme une pratique sociale, inscrite dans un contexte.
Une telle réorientation aurait aussi pour conséquence de transformer l’appréhension scolaire de la lecture – et par conséquent du rôle de l’élève. Étudier les pratiques des lettres comme des pratiques sociales, c’est libérer l’élève de l’injonction à l’admiration qui caractérise l’enseignement des « grandes œuvres ». C’est faire entrer dans l’enseignement une conception plus juste (et moins sexiste) de la lecture : non pas cette « posture féminine », passive, d’accueil ; mais une appropriation active, étroitement liée à d’autres pratiques (et notamment à l’écriture). Les chercheurs insistent depuis longtemps sur le caractère actif de la lecture, le rôle du lecteur dans la construction du sens[8]Voir notamment les travaux de Roger Chartier sur l’histoire de la lecture et ceux de Stanley Fish sur la théorie de l’interprétation. REF. Cette conception de la lecture est libératrice : il ne s’agit plus de coller à un sens préexistant, mais d’utiliser le texte dans des actions diverses. Il ne s’agit pas d’une approche relativiste : tous les usages d’un texte ne se valent pas, tous n’ont pas leur place dans un contexte scolaire. Mais cette approche permet d’expliciter les attendus de la lecture scolaire sans avoir recours à une conception essentialiste et idéaliste du texte, et par conséquent de développer chez les élèves, non pas une admiration passive (et souvent artificielle), mais des capacités d’agir.
Enfin, rendre toute leur place aux femmes dans les programmes de littérature implique de donner à voir, en même temps, le processus qui les a cantonnées à certains genres, à certains publics, puis celui qui les a exclues de l’histoire littéraire. Ce choix conduit à une histoire littéraire critique : une histoire de la distribution des valeurs, des hiérarchies et des dominations. Faire l’histoire des dominations, c’est mettre en lumière le fait qu’elles ne sont ni naturelles, ni évidentes. C’est montrer qu’elles sont le fruit d’actions, et qu’on peut agir pour les dépasser.
Marine Roussillon
Membre du Comité exécutif du PCF
en charge des questions d’éducation
Pour approfondir…
C. Planté, La Petite sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur, 1989.
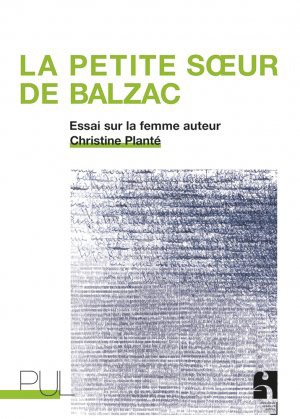
« Mauvais auteur et mauvaise femme, la femme auteur n’est pas une réalité sociale, c’est une invention, une construction fantasmatique qui incarne pour les contemporains ce qui les angoisse en une période de transformations
accélérées, ce qui menace à leurs yeux l’ordre de la famille, de la société et de la culture. C’est sur cet horizon que George Sand, Marceline Desbordes-Valmore et bien d’autres dont les noms commencent à sortir de l’oubli ont dû inventer un rapport entre ces deux termes : être femme, et écrire. »
Extrait de l’introduction en ligne : http://www.fabula.org/lht/7/plante.html
Notes[+]
| ↑1 | Il ne s’agit pas de l’épreuve de français que tous les bacheliers passent à la fin de l’année de 1ère, et dont le programme prescrit des genres et des mouvements littéraires mais laisse le choix des auteurs étudiés aux enseignants. L’épreuve de littérature est réservée aux bacheliers de la série littéraire, qui la passent en fin de Terminale. |
|---|---|
| ↑2 | https://www.change.org/p/najatvb-donnez-leur-place-aux-femmes-dans-les-programmes-de-littérature-au-bac-l |
| ↑3 | http://george2etexte.free.fr |
| ↑4 | https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-pas-d-agrégation-de-lettres-sans-autrice |
| ↑5 | Centre Hubertine Auclert. Sexes et manuels : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/sexes-manuels |
| ↑6 | Patrick Laudet, « Explication de texte littéraire, un exercice à revivifier », juin 2011. Ce texte est mis à disposition des enseignants sur le site Eduscol : http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf. Le même Patrick Laudet a été mis en cause en 2016 pour le sexisme du rapport de jury du CAPES de Lettres. |
| ↑7 | Ce fut le cas notamment avec les programmes de français de 2001, élaborés par un groupe d’experts présidé par Alain Viala, qui suscitèrent une très violente polémique. Voir notamment : A. Viala, « Querelles et légitimations », Carnets [En ligne], 9, 2017 : http://carnets.revues.org/1995 |
| ↑8 | Voir notamment les travaux de Roger Chartier sur l’histoire de la lecture et ceux de Stanley Fish sur la théorie de l’interprétation. REF |
Sur le même sujet
- Femmes et littérature : une question politique (2)
- Promouvoir l’égalité des sexes à l’école… mais laquelle ?
- Pour une culture partagée à l’école : sport pour les filles, lecture pour les garçons ?
- Le classicisme contre la République
- L’élite masculine contre l’élite féminine. L’exemple de l’enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République.


Un commentaire
Ping :