Le sens du social
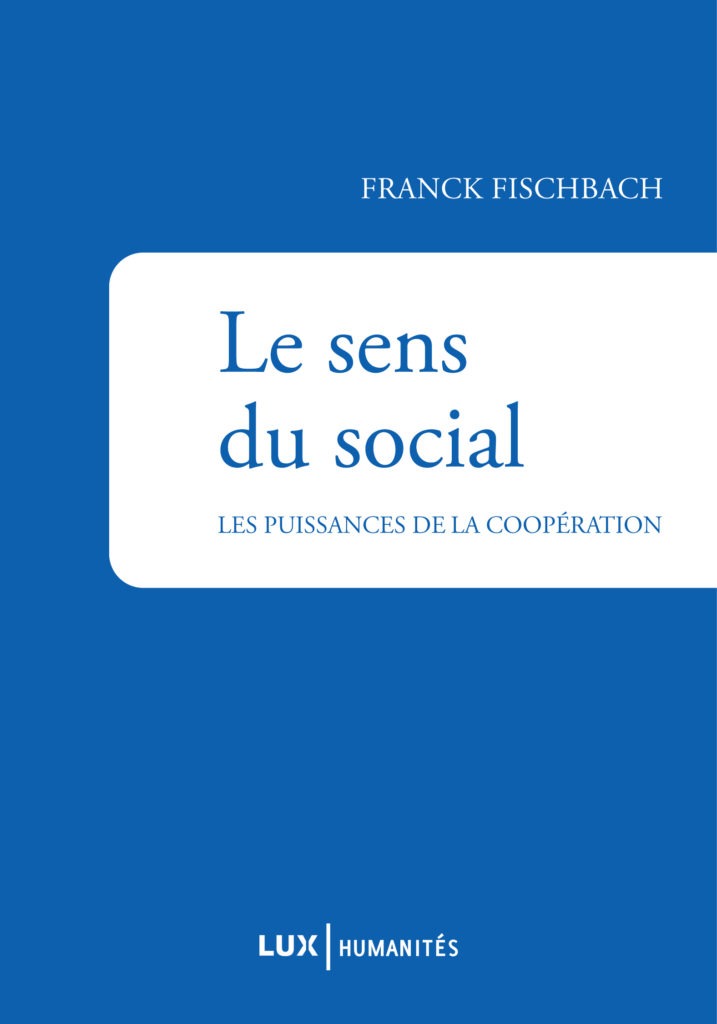
Le sens du social,
Les puissances de la coopération,
Franck Fischbach, Lux, 2015.
Note de lecture proposée par Patrick Singéry.
Penser l’école dans une perspective émancipatrice nécessite de penser non seulement les conditions et modalités de son inscription dans le champ social, mais le social lui-même. C’est ce à quoi nous invite le livre de F. Fischbach.
La victoire idéologique provisoire de la doxa libérale a été, dans un premier temps, de rendre dominante l’idée qu’à des individus prétendument libres s’opposerait un social représenté par la figure d’un Etat par nature intrusif voire oppresseur, et qu’en finir avec cet Etat permettrait l’émancipation des individus.
Pour l’auteur, cette première étape masque le fait que, derrière la fin de l’Etat « social et assurantiel », c’est la fin de l’idée même de social, de société, qui est visé. La deuxième étape tente de rendre hégémonique, dans les esprits et dans les pratiques, l’acceptation voire la revendication, par les individus considérés et se considérant eux-mêmes comme libres et égaux, de leur mise en concurrence généralisée.
A cette construction idéologique évacuant l’individu du social, l’auteur oppose le fait que, dépendant des autres, nous sommes d’abord des êtres de rapports, donc des êtres sociaux. Et que c’est précisément dans ces rapports, c’est-à-dire dans le social, que nous nous construisons comme individus.
Il y a donc urgence, nous dit l’auteur, à repenser le sens et les institutions du social. La philosophie peut y contribuer, sous réserve d’une réévaluation critique des discours et des concepts qu’elle a produits sur cette question.
Constatant ce qu’il appelle un « mépris du social » dans la production philosophique du 20ème siècle, l’auteur propose de dépasser les oppositions entre le social d’une part et le politique, le « commun », l’Etat d’autre part. Lui-même rapport social, le mode de production capitaliste, en privatisant les richesses, masque paradoxalement le caractère social de toute activité, de toute production humaine.
Selon lui, ce qui permet ces dépassements, c’est le concept de « capital », dont il rappelle au passage que c’est un rapport social : le mode de production capitaliste, en privatisant les richesses, masque le caractère social de toute activité, de toute production humaine.
L’auteur définit alors le social comme une réalité -ce que nous sommes- inséparable d’une morale : ce que nous sommes nous hausse au-delà de nous-mêmes puisque nous ne pouvons être qu’en tant qu’êtres sociaux. Cette dialectique du social comme réalité et comme morale implique pour l’auteur une troisième dimension du social : celle de ce qui est souhaitable, désirable ; une dimension « d’idéal », critique de l’existant, qui porte en elle une possible intensification de la vie sociale. C’est cette intensification que l’auteur nomme coopération et c’est selon lui dans le travail qu’elle se réalise.
La phase actuelle du capitalisme se caractérise par une désocialisation de l’économie et donc du travail, qui n’est plus envisagé comme une fonction et une activité sociales mais comme une juxtaposition de conduites individualisées. Or, le travail, vecteur fondamental de la vie sociale, doit être considéré comme « travail vivant », qui implique une dynamique de coopération, alors que le marché capitaliste du travail impose une coordination qui est l’autre nom de la domination puisqu’elle s’opère de l’extérieur. L’activité sociale qu’est le travail porte l’exigence d’une maîtrise de ses conditions objectives et matérielles de sa réalisation.
Et c’est parce que, parmi ces conditions, il y a le travail et le produit du travail d’autres, que cette maîtrise ne peut être que collective et ne peut s’exercer que par la coopération. Le collectif de travail a alors pour caractéristique de pouvoir prendre des décisions : sur lui-même, son organisation, sur les formes que prend la coopération, sur l’objet et le sens du travail…1 Cette dimension coopératrice du travail permet le développement d’une véritable forme démocratique de la vie sociale. Et l’on peut, nous dit F. Fischbach « appeler émancipation une pareille identification de la vie sociale, du travail et de la démocratie ».
Au delà du plaisir intellectuel que l’on peut éprouver à lire, par exemple, les pages sur la dialectique du « je » et du « nous » et sur l’impossibilité dans laquelle se trouvent deux électeurs conservateurs, ou Abel et Caïn, de dire à la fois « je » et « nous », ce livre peut nous permettre d’éclaircir quelques questions concrètes que se posent… les mouvements sociaux.
Comment dépasser l’opposition stérile et enfermante entre une démocratie prétendument représentative (de qui ?) et la démocratie « participative » (qualificatif dont il est politiquement urgent de la débarrasser) ? Piste possible : Si le travail est bien, comme l’avance l’auteur, le terrain d’émergence de la démocratie, cela permet de comprendre en quoi la loi dite « travail », parce qu’elle remet en cause le droit du travail, est par là même, fondamentalement, une entreprise de destruction de la démocratie. Et les formes diverses (« nuits debout », réseaux sociaux, manifs, grèves, projets alternatifs…) que prend l’opposition à cette loi marquent une volonté de faire émerger et de s’approprier des formes nouvelles et émancipatrices de démocratie.
Comment comprendre, pour mieux les combattre, les logiques identitaires (compensatrices, dit l’auteur), qui empêchent toute vie réellement sociale ?
Quels rapports, pour opérer quelles convergences, pouvons-nous établir entre des pratiques qui, alors que certaines ne sont pas explicitement anticapitalistes, remettent toutes en question les logiques de concurrence, de domination, de profit…? Y’a-t-il, par exemple, quelque chose de « commun » entre une Amap, un « fablab » et la coopérative Scop’ti des ex-Fralib, et si oui, que faisons-nous de ce commun-là?…

