Le collège unique | Laurent Gutierrez et Patricia Legris
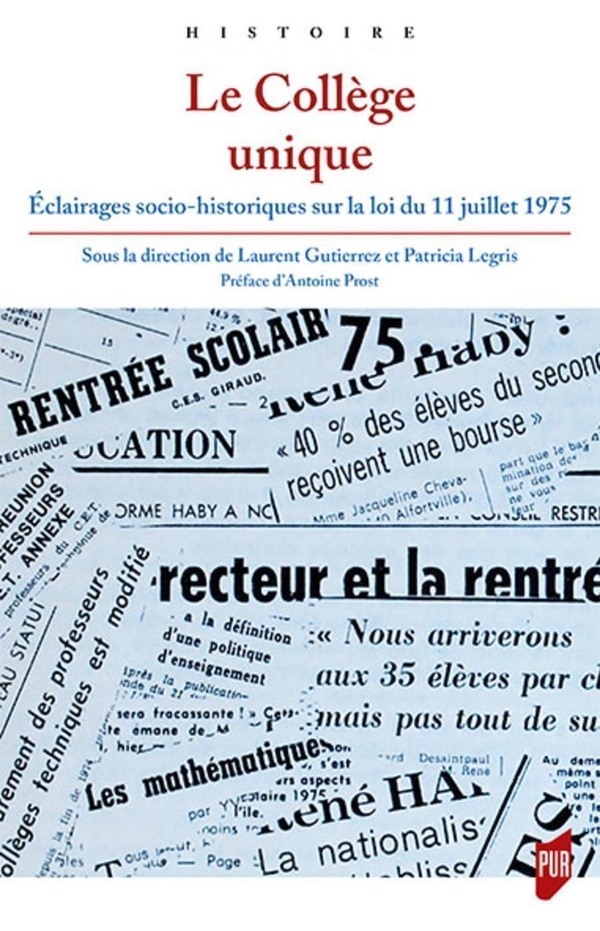
Le collège unique, éclairages socio-historiques sur la loi du 11 juillet 1975,
sous la direction de Laurent Gutierrez et Patricia Legris,
Presses universitaires de Rennes, 2016
Note de lecture proposée par Paul Devin
Que l’on s’inquiète des conséquences réelles du « choc des savoirs », de la récurrence des discours qui doutent du bien-fondé du collège unique ou des projets politiques qui proposent de revenir à une orientation précoce, la question des enjeux de la loi du 11 juillet 1975 sur le collège unique reste cruciale.
A l’occasion des quarante ans de la loi, un séminaire d’étude avait réuni une quinzaine de chercheurs dont les travaux avaient été publiés par les Presses Universitaires de Rennes.
L’ouvrage se termine par une interrogation de Pierre Merle sur l’effet égalitaire du collège unique. Force est de constater que le collège français n’est pas équitable ! Les ambiguïtés de la différenciation et l’importance du secteur privé ont largement contribué à ce que le collège unique ne parvienne pas à ses fins et soit le lieu de reproduction des inégalités.
Il faut dire que la conception et l’élaboration de la loi ne furent ni simples, ni univoques et que l’histoire de sa mise en œuvre montre bien des ambiguïtés gouvernementales. La volonté de concertation et d’information affichée par le ministère est loin de se décliner dans la réalité des échanges (Patricia Legris) y compris avec les associations de spécialistes (Renaud d’Enfert, Patricia Legris). Quant au front syndical apparemment uni, il masque des conceptions fondamentalement divergentes sur le rôle du collège qui vont perdurer jusqu’à l’éclatement de la FEN (Ismaël Ferhat et André D. Robert).
Mais la question qui reste la plus complexe est celle du paradoxe qui conduit un gouvernement de droite libérale à décider de la suppression de filières désormais perçues comme ségrégatives. Qu’y avait-il derrière cette volonté de modernisation à laquelle Giscard d’Estaing semblait si fortement attaché ?
La détermination des travaux de la sociologie critique a sans aucun doute pesé fortement pour convaincre de l’importance de la question de l’échec scolaire et de ses effets inégalitaires (André D. Robert) d’autant qu’une évolution démocratisante était en cours depuis la Libération.
Mais la question qui reste insuffisamment traitée est celle des motivations économiques et sociales de cette évolution. L’expression par Giscard et Haby d’une finalité de « savoir minimum » suffit-elle à garantir une perspective de démocratisation réelle ? Dans le contexte giscardien de néolibéralisation de la politique économique et sociale, les syndicats comme les parents d’élèves ont quelque difficulté à en être convaincus… Que René Haby, tout en considérant la réalité des inégalités de développement, ait pu être persuadé d’œuvrer à une plus grande justice (Catherine Dorison et Pierre Kahn) ne résout pas la question. D’autant que, dans une interview postérieure, Haby convient que « l’égalité des chances » n’était pas la motivation essentielle de la loi. On aurait aimé que les liens entre la planification des besoins économiques, notamment en termes de qualification de l’emploi, soient davantage traités et que nous puissions mesurer comment les évolutions entre les plans successifs ont joué tant dans leurs perspectives budgétaires que dans celles de définir les besoins d’emplois qualifiés. On y aurait sans doute trouvé la possibilité de mieux comprendre les motivations néolibérales de la suppression des filières. Rien qui puisse, dans un tel travail, risquer une simplification outrancière car les multiples difficultés d’élaboration de la loi et les divergences au sein du gouvernement dont elles témoignent (Laurent Gutierrez) comme les débats critiques qui l’ont suivie (Ludivine Balland) suffisent à dissuader de tout simplisme interprétatif.
Il n’en reste pas moins nécessaire de tenter, au travers de l’élaboration de cette loi, de mieux comprendre les relations des idéologies néolibérales avec leurs politiques scolaires. Dans une période où nous craignons le retour d’un tri social plus violent, voire d’orientations précoces, le tout sous la justification rhétorique d’une meilleure réussite de tous les élèves, il importe que nous puissions mieux comprendre, en régime capitaliste, les raisons profondes des écarts persistants entre la promesse d’égalité républicaine et la réalité scolaire.

